Boisson-totem, comme l'a souligné R. Barthes dans ses « Mythologies », le vin est également un produit tabou (1). Mais si, aujourd'hui, l'information selon laquelle l'alcool est une drogue a fait son chemin, elle ne doit pas occulter l'abus ou l'usage nocif.
Le repérage de l'alcoolisme doit se développer.
Les modalités de consommation conduisent, en effet, à distinguer l'usage, l'usage à risque (risque situationnel, par exemple chez la femme enceinte, risque quantitatif), l'usage nocif ou abus, caractérisé par « une consommation répétée induisant des dommages » et la dépendance (2). L'usage nocif est la résultante de l'interaction entre les facteurs de risque liés aux produits, notamment les modalités de consommation, des facteurs individuels et les facteurs environnementaux, familiaux et sociaux. Les mésusages sont encouragés par l'industrie alcoolière, très innovante en matière de dénominations, de goûts et de packaging, ce d'autant que leur absence de représentation sociale permet au sujet de considérer qu'il n'est pas « alcoolique ». Par ailleurs, le repérage des pathologies alcooliques est insuffisant et trop tardif. Aux urgences, par exemple, en cas de mésusage d'alcool, des soins ne sont proposés qu'à moins de 5 % des patients. L'identification des mésusages d'alcool par un repérage précoce implique de savoir caractériser la consommation du patient, d'effectuer des dosages, en particulier celui de la transferrine désialylée (CDT), dont la spécificité est très bonne (4), d'utiliser des questionnaires comme le DETA et, enfin, de chercher des facteurs de gravité comme les modalités de consommation. Il faut associer les marqueurs entre eux et avec l'interrogatoire, en sachant qu'ils sont moins sensibles pour les femmes et les adolescents, et qu'ils permettent de motiver les patients.
Des conséquences visibles en imagerie.
Les conséquences cérébrales de l'addiction ont été explorées grâce à l'imagerie par tomographie par émission de positons (3). Elle s'accompagne d'une perturbation de plusieurs circuits cérébraux : les circuits de la récompense, de la motivation, de la mémoire, et du contrôle cortical qui résout les conflits internes. Le cerveau adolescent est plus sensible aux dommages liés à l'alcool. L'usage abusif entraîne en particulier des troubles de l'apprentissage, de la mémoire et de l'attention, et la maturation du cerveau s'effectue par vagues successives, comme l'a montré l'imagerie par résonance magnétique (5). La prise en charge des mésusages de l'alcool peut faire appel à la chimiothérapie et/ou à une stratégie motivationnelle, conformément à la description des niveaux de motivations de Prochaska et DiClemente (6), aux interventions brèves, dont l'efficacité et le bon rapport coût/efficacité sont largement documentés, aux interventions structurées ou aux thérapies cognitivo-comportementales.
D'après un entretien avec le Pr Michel Reynaud, hôpital universitaire Paul-Brousse, Villejuif.
(1) Craplet M. La question alcool dans l'histoire de la France contemporaine. Toxibase 2004(16):1-5.
(2) Reynaud M et coll. Usage nocif de substances psychoactives : identification des usages à risque, outils de repérage, conduites à tenir. Paris, La Documentation française, 2002.
(3) Volkow ND et coll. The addicted human brain : insights from imaging studies. J Clin Invest 2003;111(10):1444-51.
(4) Schellenberg F et coll. Dose-effect relation between daily ethanol intake in the range 0-70 grams and % CDT value : validation of a cut-off value. Alcohol and Alcoholism 2005 ;40(6):531-4.
(5) Gogtay N et coll. Dynamic mapping of human cortical development during childhood through early adulthood. Proc Natl Acad Sci USA 2004;101(21):8174-9.
(6) Prochaska JO, DiClemente CC et coll. In search of how people change : applications to addictive behaviors. American Psychologist 1992;47:1102-14.
Une évolution récente des pratiques d'alcoolisation
Sur le plan épidémiologique, chez les adolescents, l'usage régulier d'alcool est en hausse. C'est un comportement d'autant plus masculin que la fréquence de consommation est élevée. Les bitures expresses, traduction française du binge drinking, sont des ivresses massives. Elles sont devenues un problème de santé publique important entraînant une augmentation de 50 % des comas éthyliques et d'un tiers des pancréatites et hépatites aiguës. Elles sont à rapprocher du fait que l'alcool est la première cause de mortalité routière chez les 15-30 ans.
Chez les adultes, l'usage d'alcool augmente régulièrement avec l'âge. Environ 9 % des adultes peuvent être considérés comme ayant ou ayant eu un usage problématique d'alcool. Ce type de consommation augmente globalement avec l'âge et concerne environ 4 millions d'adultes. L'ivresse concerne environ 14 % de la population, avec un pic entre 18 et 25 ans (elle concerne alors 51 % des hommes et 22 % des femmes). La manière de boire varie avec la catégorie socioprofessionnelle et le niveau d'études. Ainsi, 10 % des étudiants du supérieur déclarent plus de 10 ivresses dans les douze derniers mois. Enfin, globalement, les cadres femmes déclarent plus souvent boire tous les jours ou avoir été ivres que les femmes des autres catégories professionnelles, alors que c'est l'inverse pour les hommes.
Beck F et coll. Évolutions récentes des pratiques d'alcoolisation en France : aperçu des données épidémiologiques. Toxibase 2004 (16) : 6-9.

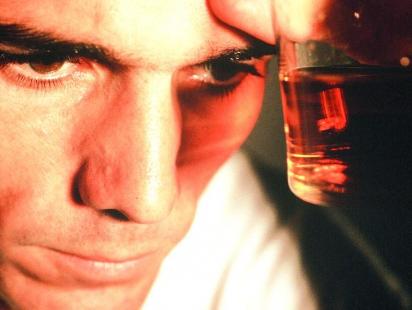
Pause exceptionnelle de votre newsletter
En cuisine avec le Dr Dominique Dupagne
[VIDÉO] Recette d'été : la chakchouka
Florie Sullerot, présidente de l’Isnar-IMG : « Il y a encore beaucoup de zones de flou dans cette maquette de médecine générale »
Covid : un autre virus et la génétique pourraient expliquer des différences immunitaires, selon une étude publiée dans Nature