L'IMAGE médicale est une puissante alliée du clinicien. Mais au rythme des innovations, des progrès et des controverses, cette amie est parfois devenue source de difficultés : la profusion des évolutions aidant, on peut être tenté de s'en tenir aux « bonnes vieilles méthodes » : au regard d'une complexité et d'une multiplicité sans cesse croissante de « l'offre » en imagerie médicale, le médecin prescripteur peut choisir le statu quo, les méthodes anciennes : c'est un premier risque.
Le second risque tient à l'exposition médiatique croissante de ce domaine d'activité : le grand public constitue désormais une cible privilégiée de l'innovation médicale, qu'il « digère » aussi bien que possible et, reconnaissons-le, de façon parfois un peu hétérogène. Le médecin, dès lors, se trouve exposé à la pression de son propre patient, au risque de passer pour ignorant des progrès et des évolutions de son art… Une médiatisation mal contrôlée peut parfois orienter vers la « surpromesse », générant ainsi déception et perte de confiance.
Nous pensons que seule la remise en perspective clinique peut constituer une solution recevable à cette problématique. La démarche « clinique » constitue un élément central du service rendu au malade. Elle suppose la mise en réseau d'expertises, la coopération entre spécialistes, dont une des matérialisations récente est le développement des « réunions de concertation multidisciplinaires » (RCM).
Au plan purement technologique, l'évolution de l'imagerie dans les années à venir peut se schématiser comme suit.
Échographie
S'agissant de l'échographie, la qualité des images est en constante amélioration, notamment par augmentation de la puissance de calcul des appareils de dernière génération ; l'utilisation de produits de contraste (microbulles de très petit volume), en tenant compte de précautions strictes, autorise une étude dynamique qualitative de la perfusion des différents organes, par exemple au niveau hépatique. Elle demeure encore limitée pour l'évaluation quantitative, par son caractère opérateur dépendant, par sa difficulté de reproductibilité, et l'impossibilité qu'il y a à fusionner ses images avec les autres technologies.
Scanner
Le scanner est devenu, de fait, un instrument « multimodal » : il apporte des informations anatomiques, morphologiques, dynamiques, fonctionnelles, et connaît des expansions technologiques par l'amélioration de l'acquisition (option bitubes, augmentation future du nombre de barrettes – 128 et 256) et du traitement des images. Au cours d'une même étude, il peut détecter ou surveiller, à partir de coupes natives simples, mais aussi apporter des informations plus sophistiquées : imagerie endoscopique virtuelle analysant toute région du corps humain (coloscopie virtuelle, SRA 1996), imagerie de perfusion pour le suivi thérapeutique (ASCO, mai 2008, « le Quotidien du Médecin » du 4 juin 2008), coroscanner (voir ci-après), représentation en 3D volumique pour l'aide au chirurgien ou au radiothérapeute. La possibilité de visualiser convenablement les artères coronaires en scanner a sans nul doute constitué un apport important ces dernières années, mais représente également un exemple caractéristique de « surpromesse surmédiatisée » ayant, au final, généré certaines frustrations. En technologie 64 barrettes, le scanner est un bon examen pour éliminer une insuffisance coronaire, lorsque la probabilité de cette maladie est faible, par exemple chez un sujet relativement jeune, présentant des signes fonctionnels peu évocateurs, mais chez lequel la preuve de l'absence de maladie coronaire est souhaitée pour une raison ou pour une autre. Les autres indications sont plus controversées, et peuvent conduire à des erreurs d'orientation diagnostiques et thérapeutiques.
Les deux atouts principaux du scanner, outre sa disponibilité et son intérêt pour le dépistage de masse (cancer pulmonaire, à l'étude), n'en demeurent pas moins, d'une part, sa reproductibilité et, d'autre part, le fait qu'il s'agit d'une technique dont les résultats sont quantifiables. Les images tomodensitométriques peuvent être fusionnées avec celles des autres technologies (Tep-scan, scan-IRM, scan-angioscan ou 3D). Le scanner n'intervient plus uniquement pour confirmer un diagnostic clinique, mais aussi pour évaluer le pronostic et guider les choix thérapeutiques. L'irradiation constitue une problématique qui devrait se résoudre progressivement par l'utilisation de systèmes de réduction de dose.
IRM
L'IRM, d'accès plus limité et plus onéreux, connaît également une évolution qui est non seulement morphologique, mais aussi « physiologique », intégrant aux informations anatomiques des données fonctionnelles, dynamiques, chimiques et structurelles. Les principales avancées sont : l'amélioration des antennes de surface, la recherche de nouveaux produits de contraste et de nouvelles séquences, l'imagerie de perfusion, avec étude dans le temps d'un contraste paramagnétique, l'IRM d'activation ou « fonctionnelle », la tractographie qui analyse l'anatomie des faisceaux neurologiques, l'IRM de diffusion qui étudie la structure physique d'un tissu biologique très au-delà de la résolution habituelle de l'IRM. Cette dernière technique reflète la capacité de diffusion spécifique d'un tissu, pouvant laisser espérer une meilleure caractérisation et un meilleur suivi thérapeutique, voire une cartographie corps entier. L'IRM, globalement, est reproductible et peut être fusionnée (Tep-IRM, IRM-scan, IRM-ARM…). En revanche, son caractère quantitatif est plus aléatoire, les protocoles d'étude n'étant pas standardisés ni, de ce fait toujours reproductibles. Elle offre parallèlement la possibilité d'analyser la composition chimique des lésions par spectroscopie (spectro-IRM). Les performances des machines 3T sont en cours d'évaluation.
PET-scan
L'importance du PET-scan dans le suivi de certains cancers et leur bilan d'extension initial n'est plus à démontrer. Le nombre d'équipements installés en France poursuit lentement sa progression.
Sur le plan technique, plusieurs évolutions sont attendues : l'amélioration de la résolution spatiale des détecteurs TEP, actuellement autour de 6/8 mm, pourrait descendre à 2 mm. L'augmentation du nombre de machines équipées d'un scanner haut de gamme ouvre quant à elle la possibilité de bilans complets en un seul temps. En sus du « FdG », glucose marqué, traceur métabolique non spécifique, la mise sur le marché de la 18 fluorocholine pourrait ouvrir les indications de la TEP au cancer de la prostate.
Par ailleurs, il est fort possible que le champ d'application de la TEP ne se limite plus aux seules indications oncologiques dans les années à venir, mais s'élargisse aux maladies neurologiques, ainsi qu'aux cardiopathies ischémiques. Les travaux les plus récents suggèrent en effet que la TEP serait un examen performant pour un dépistage précoce de la maladie d'Alzheimer, avant l'apparition des signes cliniques. Dans le domaine de la cardiologie, le 82 Rubidium pourrait offrir une alternative intéressante aux scintigraphies « classiques », permettant notamment une quantification de la réserve coronaire et la diminution des artefacts.
Gamma caméras
Dans le domaine plus traditionnel des « gamma caméras », d'importantes innovations sont également en marche, avec, entre autres , l'apparition de détecteurs tungstène, permettant tout à la fois une réduction drastique de la durée des examens et une amélioration de leurs performances. Il convient de rappeler à ce sujet que la scintigraphie « classique », qu'il s'agisse de l'exploration thyroïdienne, du bilan de métastases dans le cancer du sein ou de la prostate, ou de l'évaluation fonctionnelle de la maladie coronaire, reste la modalité fonctionnelle par excellence, le «standard» sur lequel se référencent les modalités à vocation initialement anatomique que sont l'échographie, l'IRM ou le scanner.
Une approche intégrée
Passé ce rapide survol, notre objectif est de proposer – dans une série d'articles à venir – une approche de l'imagerie qui soit « intégrée » aux arbres décisionnels cliniques, tenant compte des performances des examens, mais aussi de leurs éventuels risques ou pénibilité, ainsi que de leurs coûts.
Il nous apparaît essentiel en effet de pouvoir justifier qu'une exploration est nécessaire à la prise en charge d'un patient, parce qu'elle influence les choix thérapeutiques, et qu'en définitive ces choix thérapeutiques conduisent à un bénéfice réel. La crédibilité de la démarche diagnostique, désormais, est à ce prix. L'image ne vaut pas pour elle-même : elle ne tire sa valeur que des décisions prises en aval, dès lors que ces décisions ont une efficacité prouvée.
Ce « rétroplanning », que chacun effectue mentalement, dessine en filigrane les contours d'un « plateau technique global », regroupant l'ensemble des modalités, disponible sur de larges plages horaires, et permettant au clinicien de trouver sur place l'expertise nécessaire au meilleur choix des examens devant être réalisés pour répondre à un problème donné.
Cette architecture garantit à la fois une optimisation de la qualité des prestations et une réduction des coûts. Elle se situe sur un chemin de crête étroit, entre la sous-prescription par déficit d'information, génératrice de retards diagnostiques et de perte de chances, et la « surprescription mimétique », génératrice notamment de surcoûts.
Remerciements à J.-C. Piette pour ses conseils scientifiques.


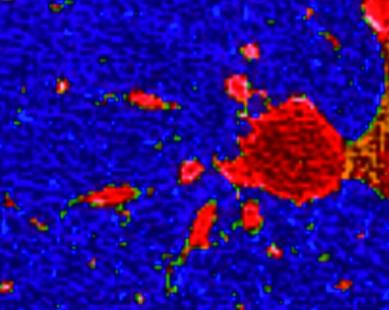
Pause exceptionnelle de votre newsletter
En cuisine avec le Dr Dominique Dupagne
[VIDÉO] Recette d'été : la chakchouka
Florie Sullerot, présidente de l’Isnar-IMG : « Il y a encore beaucoup de zones de flou dans cette maquette de médecine générale »
Covid : un autre virus et la génétique pourraient expliquer des différences immunitaires, selon une étude publiée dans Nature