LE PREMIER DOSSIER médical personnel (DMP) est né mercredi 14 juin, à 16 heures, chez un médecin généraliste d’Aquitaine.A la grande satisfaction du GIE Santeos (1), qui a pris un peu d’avance sur ses cinq concurrents (2). Ces derniers ont confié au « Quotidien » qu’ils étaient en mesure d’ouvrir leurs premiers DMP dans une à deux semaines. Lancé officiellement le 1er juin par le groupement d’intérêt public (GIP), après l’avis favorable de la Commission nationale informatique et libertés (Cnil) et du comité d’agrément, le dispositif expérimental a nécessité plusieurs étapes préalables. «Il a fallu imprimer des milliers de documents, des notes d’information et des contrats, et les distribuer auprès des médecins de toutes les régions pilotes», commente Tudy Bernier, responsable du projet DMP à France Telecom.
Chaque patient qui souhaite ouvrir un DMP devra signer un contrat personnalisé avec l’hébergeur (voir encadré), dont le GIP a dessiné les grandes lignes. A cette occasion, le patient remplira également un formulaire précisant quels médecins il autorise à ouvrir et à consulter son DMP.
La rémunération des médecins au coeur des débats.
La machine est enfin lancée, mais le début des expérimentations, en plein été, devrait freiner la montée en charge du dispositif avec les départs en vacances des patients et des médecins. Les consortiums s’attendent donc à atteindre le seuil des 5 000 dossiers médicaux à l’automne. «Pour que cette expérimentation ait un sens, les médecins vont ouvrir des dossiers pour les patients qui nécessitent une prise en charge médicale soutenue», explique Sylvie Ouziel, présidente d’Invita.
Pour l’anecdote, l’ouverture du premier DMP a coïncidé avec le divorce de l’Urml Midi-Pyrénées et du comité de pilotage régional (voir ci-dessous). La rémunération des médecins est au coeur des débats. Une majorité de consortiums a décidé de ne pas payer les médecins pour la tenue des dossiers médicaux pendant les expérimentations. «Nous avons étudié la question et conclu qu’elle n’était pas de notre ressort mais des instances professionnelles», souligne Tudy Bernier. «Nous n’allons pas rémunérer le médecin mais mettre gratuitement à sa disposition le logiciel de gestion du cabinet qui lui évitera les doubles saisies», explique Francis Mambrini, directeur du projet DMP pour Cegedim. Seul le GIE Santeos a prévu pour la création et l’utilisation du DMP un « défraiement du médecin de 200 à 700euros en fonction du nombre de dossiers ouverts», confie le Dr Robin.
Les consortiums sont conscients que le bouleversement du paysage syndical, à l’issue des élections aux unions régionales des médecins libéraux, ne les met pas à l’abri d’éventuels blocages. «Ces élections ne seront pas neutres et de nouveaux mouvements d’humeur ne sont pas à exclure, commente Michel Jan, responsable du secteur santé social chez Bull. Mais ils ne seront que passagers car il y a une réelle volonté de faire aboutir ce projet.» Les expérimentations, initialement prévues pour durer quatre mois, pourraient en durer deux de plus. Elles seront l’objet d’évaluations permettant de juger les solutions techniques retenues, mais aussi les conditions d’accès au DMP ou la sécurisation des données. La généralisation du DMP au printemps 2007 s’effectuera cependant selon une toute autre organisation que celle qui préside aux expérimentations.
La Caisse des dépôts et consignations sera tenue d’ouvrir un portail Internet unique et sécurisé pour tous les patients qui souhaiteront ouvrir leur DMP. Un seul hébergeur de référence sera désigné à l’automne à l’issue de l’appel à projets que s’apprête à lancer le GIP-DMP dans les prochaines semaines.
(1) Santeos (Atos, Unimédecine, HP, Strateos).
(2) Cegedim, Thalès ; D3P (RSS, Microsoft, Medcost/Doctissimo) ; France Telecom, IBM, Cap Gemini, SNR ; InVita, Accenture, La Poste, neuf cegetel, Intra Call Center, Jet Multimedia, Sun Microsystens ; Samténergie (Siemens, Bull, EDS).
Le contrat d’hébergement du DMP
La signature d’un contrat d’hébergement du dossier médical entre le consortium et le patient est indispensable avant l’ouverture de chaque dossier médical personnel.
Il précise les conditions dans lesquelles l’hébergeur s’engage à fournir au patient des prestations d’hébergement du DMP pendant la phase d’expérimentation et dans les sites pilotes définis.
Le patient recevra un numéro d’identifiant santé (NIS) de la part du GIP-DMP. Le contrat d’hébergement du DMP prévoit que le consortium devra fournir au patient une adresse qualité santé (AQS) et assurer les éléments de sécurité d’accès à son dossier. L’hébergeur est ainsi tenu de créer le DMP, de le rendre accessible, et de permettre son accès à tout moment au patient et aux personnes autorisées par le patient. Il doit permettre l’alimentation, la modification et le masquage des données de santé, garantir leur stockage, leur conservation et leur protection, et garantir la traçabilité et la conservation de l’historique des actions réalisées dans le cadre de l’utilisation du DMP.
L’hébergeur s’engage également à prendre toutes les mesures nécessaires auprès de son personnel et de ses sous-traitants éventuels afin que soit respecté le secret professionnel.
A la fin de l’expérimentation, d’ici à la fin de l’année, le patient pourra exiger de son hébergeur la restitution du DMP et de toutes les données identifiantes attachées. S’il n’exprime pas son choix à l’hébergeur dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la fin de l’expérimentation, l’hébergeur pourra procéder à la destruction des données de santé du patient. Le contrat prévoit en cas de litige la possibilité pour le patient de contacter le « médecin de l’hébergeur » et un médecin qu’il aura désigné pour intervenir en qualité de conciliateurs.
Lire aussi :
> LUrml Midi-Pyrénées se désengage de lexpérimentation régionale

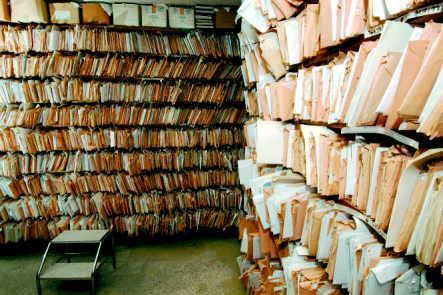
Pause exceptionnelle de votre newsletter
En cuisine avec le Dr Dominique Dupagne
[VIDÉO] Recette d'été : la chakchouka
Florie Sullerot, présidente de l’Isnar-IMG : « Il y a encore beaucoup de zones de flou dans cette maquette de médecine générale »
Covid : un autre virus et la génétique pourraient expliquer des différences immunitaires, selon une étude publiée dans Nature