On en parlait depuis longtemps mais, lors de la CROI 2007, on a pu découvrir des résultats très prometteurs d’anti-intégrases, le raltegravir (MK 0518) étant celle dont le développement est le plus avancé (phase III) alors que l’elvitegravir (GS-9137) est en phase II. On note en particulier la rapidité d’action antivirale de ces molécules, même si on décrit déjà des résistances.
Le raltegravir de MSD a fait l’objet de deux essais de phase III, Benchmrk 1 (Europe et Asie Pacifique) et 2 (Amérique du Nord et du Sud), versus placebo, sur un total de 700 patients en situation d’échec thérapeutique (résistances aux trois classes d’antirétroviraux, ARN viral à plus de 1 000 copies/ml).
Au terme de seize semaines de suivi, on note de 61 à 62 % de charges virales indétectables (< 50 copies/ml) contre 33 à 36 % dans le groupe placebo (p < 0,001). Parallèlement, on observe une augmentation significativement supérieure des CD4 (p < 0,001), dans les groupes recevant du raltegravir (400 mg x 2/j). Alors que 60 % des patients bénéficient d’un recul de vingt-quatre semaines, la supériorité du traitement actif se maintient. Enfin, la tolérance du traitement apparaît globalement satisfaisante, avec un pourcentage d’effets secondaires équivalents dans les deux bras des deux études. Le souci pourrait venir de la tolérance à long terme, encore inconnue, mais aussi et surtout des résistances : si les échecs virologiques sont moins fréquents dans les bras raltegravir que sous placebo (16 versus 51 %), 32 des 41 échecs du raltegravir s’expliquent par une modification génotypique de l’intégrase VIH.
Ce qui conduit d’ailleurs les chercheurs de MSD à travailler sur une nouvelle génération d’inhibiteurs d’intégrase (MK 2048) qui agit à un autre stade de l’intégration intracellulaire du virus et qui semble capable de conserver une activité antirétrovirale sur les souches ayant perdu leur sensibilité à la première génération d’anti-intégrases.
Le GS-9137.
Dans l’immédiat, l’autre candidat est l’elvitegravir (GS-9137) de Gilead qui a fait l’objet d’un essai de quarante-huit semaines portant sur un total de 278 patients. Cet essai de non-infériorité a comparé chez des patients recevant, par ailleurs, 2 ou 3 Nrti, trois doses (20, 50 ou 125 mg) d’elvitegravir associé à 100 mg de ritonavir ou une antiprotéase boostée par le ritonavir. A l’inclusion, ces patients présentaient une charge virale importante (en moyenne, 4,59 log 10 copies/ml), des CD4 à 185 cellules/mm3 et une moyenne de 11 mutations de résistance aux antiprotéases.
On constate que, aux doses de 50 et 125 mg/j, l’elvitegravir est au moins aussi efficace que l’antiprotéase boostée ; une efficacité qui à la dose de 125 mg/j est même plus importante et précoce, ce qui fait l’intérêt des anti-intégrases, note le Pr A. Zolopa (Stanford School of Medicine). Enfin, comme pour le raltegravir, la tolérance est globalement satisfaisante.
On le voit, les anti-intégrases n’ont pas fini de faire parler d’elles, d’abord chez les patients multitraités et en échec thérapeutique. Mais leur place dans les stratégies thérapeutiques est loin d’être déterminée.

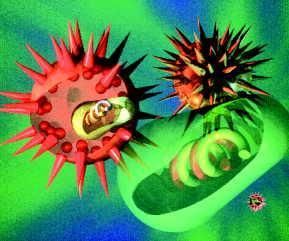
Pause exceptionnelle de votre newsletter
En cuisine avec le Dr Dominique Dupagne
[VIDÉO] Recette d'été : la chakchouka
Florie Sullerot, présidente de l’Isnar-IMG : « Il y a encore beaucoup de zones de flou dans cette maquette de médecine générale »
Covid : un autre virus et la génétique pourraient expliquer des différences immunitaires, selon une étude publiée dans Nature