. Volet « Médicament »
1) Médicament utilisé en thérapeutique ambulatoire : Entresto (sacubitril/valsartan), un progrès dans l'insuffisance cardiaque sévère
Indiqué dans l'insuffisance cardiaque (IC) chronique symptomatique avec fraction d'éjection réduite, Entresto agit sur deux systèmes différents, dont l'un n'avait jamais été ciblé à ce jour, le système de la dégradation des peptides natriurétiques.
Entresto associe du sacubitril, un nouvel inhibiteur de la néprilysine, qui diminue la dégradation des peptides natriurétiques, et du valsartan, un antagoniste des récepteurs à l'angiotensine II du système rénine-angiotensine-aldostérone.
L'efficacité d'Entresto a été apportée par l'étude de phase III PARADIGM-HF qui a comparé la nouvelle association à l'énalapril le traitement de référence chez 8 400 patients. Dans le groupe Entresto, la mortalité toutes causes confondues a été diminuée de 16 %, la mortalité cardiovasculaire ou d'hospitalisation pour IC de 20 %, les symptômes et limitations significativement réduits.
2) Médicament réservé en thérapeutique hospitalière : Darzalex (daratumumab), 1er anti-CD38 dans le myélome multiple
La Darzalex (daratumumab) est le premier anticorps à avoir démontré une efficacité en monothérapie dans le myélome multiple (MM). Le daratumumab cible la protéine CD38, qui est exprimée en grandes quantités à la surface des cellules du MM. Cet anticorps monoclonal recombinant induit la mort cellulaire par des mécanismes d'action directs et indirects.
Le daratumumab a obtenu son AMM en Europe en mai 2016 en monothérapie pour le traitement des patients atteints d'un MM en rechute et réfractaire, dont les traitements antérieurs incluaient un inhibiteur de protéasome et un immunomodulateur et dont la maladie a progressé lors du dernier traitement.
Au vu des études CASTOR et POLLUX, l'indication a été élargie en avril 2017 aux associations daratumumab, lénalidomide et dexaméthasone, ou bortézomide et dexaméthasone chez les patients ayant déjà reçu au moins une ligne de traitement.
Le daratumumab est actuellement étudié sur toutes les lignes de traitement du MM, y compris en 1re ligne. Son administration en sous-cutané est également en cours d'étude.
3) Médicament destiné aux maladies rares : Revestive (téduglutide) dans le syndrome de grêle court, à partir de l'âge de 1 an
Revestive (téduglutide) a l'AMM dans le syndrome du grêle court (SGC) chez l'adulte (2012) et chez l'enfant âgé de plus de 1 an (2016). Cet analogue du GLP-2 permet de réduire les perfusions de nutrition parentérale (NP) voire d'obtenir un sevrage total.
Le SGC est essentiellement dû à un infarctus mésentérique chez l'adulte, alors que chez l'enfant, les causes les plus fréquentes sont les anomalies congénitales et l'entérocolite ulcéro-nécrosante du prématuré. Le SGC est à l'origine d'une malabsorption intestinale sévère, nécessitant parois un support nutritionnel et hydroélectrolytique en NP pendant des années, voire à vie.
Le téduglutide pourrait être particulièrement utile chez les patients ayant un niveau de dépendance relativement modéré dans l'espoir d'obtenir un sevrage de la NP. Revestive bénéficie d'un statut de médicament orphelin mais singulièrement d’une distribution en circuit « ville » depuis juillet 2016.
. Volet « Dermocosmétique et dermatologie esthétique »
1) Catégorie travaux de recherche : travaux sur le rôle de la microvascularisation cutanée dans la pigmentation du Pr Thierry Passeron
Le laboratoire du Pr Thierry Passeron (service de dermatologie du CHU de Nice et responsable d'une équipe INSERM du centre méditerranéen de médecine moléculaire) est spécialisé dans la pigmentation et le mélanome. Le prix Galien, catégorie travaux de recherche, vient récompenser ses travaux sur le rôle de la microvascularisation dans la pigmentation cutanée. « Les Asiatiques avaient montré, il y a plus de 10 ans, que l'augmentation de la pigmentation s'accompagnait d'une augmentation de la vascularisation », explique-t-il au « Quotidien » mais la relation entre les deux phénomènes était encore inconnue.
L'équipe du Pr Passeron a élucidé cette question dans une étude publiée en 2015 dans le « Journal of Investigative Dermatology ». En cultivant côte à côte des mélanocytes et des cellules endothéliales issues des vaisseaux microvasculaires, les chercheurs niçois ont montré que les cellules endothéliales stimulent la mélanogenèse, via la production d'endothéline 1, qui se fixe sur le récepteur spécifique EDNRB des mélanocytes.
Le Pr Passeron s'est déclaré « très heureux » de remporter le prix Galien. « Il est important d'aider ce genre de recherche fondamentale qui va permettre des débouchés cliniques », ajoute-t-il. Un premier essai américain a d'ores et déjà montré que l'inhibiteurs du récepteur B, l'acide tranexamique (indiqué dans la prévention des saignements en chirurgie et lors d'un accouchement), diminue de 38 à 40 % la pigmentation de la peau de patientes atteintes de mélasma. « L'acide tranexamique n'est pas ans effet secondaire, note le Pr Passeron, il serait plus efficace de développer un inhibiteur du récepteur B en application topique. »
2) Catégorie produit : Clairial Sérum, un nouveau correcteur anti-taches pour le visage, efficace dès le 14e jour de traitement
Clairial Sérum, un nouveau correcteur antitaches, tient son originalité de l'utilisation d'un actif mimétique de la blancheur palmo-plantaire, le dérivé du férulate. Le sérum régule de façon inédite deux phénomènes physiopathologiques récemment découverts dans l'hyperpigmentation : la voie fibroblastique (DKK-1) dans la blancheur palmo-plantaire et la voie vasculaire (EDN-1).
Outre le dérivé du férulate, le sérum est composé d'un micro-organisme marin, d'un complexe Duowhite et de vitamine C stabilisée. Un essai clinique a évalué l'application quotidienne du sérum pendant 12 semaines chez 60 volontaires de 3 phototypes différents (caucasien, asiatique, métisse ou nord-africain) présentant des taches pigmentaires sur le visage (25 % avec mélasma et 100 % avec lentigo). Efficace dès le 14e jour de traitement, Clairial Sérum a diminué de 30 % la surface, l'intensité et la densité des taches, avec des effets durables 3 semaines après l'arrêt.
. Volet « Accompagnement du patient »
La Fédération Cheer Up accompagne les adolescents et jeunes adultes touchés par le cancer dans la réalisation de leurs projets, et sensibilise le grand public à leur sort.
La Fédération a été lancée en 2003 par Pierre Janicot, reçu à l'ESSEC après avoir surmonté un cancer en classes préparatoires, et son ami Marc Sudreau (EDHEC), sur la base d'un double constat : les jeunes malades sont trop isolés dans les services d'oncologie ; ce sont les projets qui aident à lutter contre la maladie.
Cheer Up est présente dans 20 grandes écoles et universités, dont les élèves bénévoles sont formés (350 chaque année) et suivis psychologiquement, pour rendre visite aux jeunes de 15 à 29 ans, dans les services d'oncologie de 28 hôpitaux labellisés, et les aider à réaliser leurs rêves.
Compte tenu de l'essor de l'ambulatoire, Cheer Up entend développer les visites à distance à domicile, via Facebook, skype, et dans les hôpitaux où la fédération est absente. Une équipe Projet 2.0 vient d'être créée, une application est en cours de construction.
Le Prix Galien salue « une initiative originale qui tient compte de la spécificité de l'adolescence dans la prise en charge du cancer, et un projet motivant ».
. Volet « dispositif médical »
EOS, la machine à cartographier le squelette : Assis, debout, en extension... en permettant la prise de clichés radiologiques en 3 dimensions, la plate-forme EOS est un nouvel outil précieux pour la recherche et la planification de la chirurgie orthopédique. Les patients y entrent et peuvent adopter n'importe quelle position dans l'espace. La plate-forme prend 2 images suivant 2 plans (coupe frontale et coupe sagittale) qui servent à reconstituer une image en 3 dimensions à même d'être exploitée par une suite de logicielle en ligne destinée aux chirurgiens. La société française EOS imaging, basée à Paris et dotée de 5 filiales dans le monde, a mis au point cette technique d'imagerie innovante qui remporte le prix Galien du dispositif médical. Le Jury a récompensé « une réelle innovation dans le domaine de l'orthopédie » et une « success story à la française ».
À Paris, l'institut de biomécanique humaine Georges Charpak s'articule notamment autour de l'EOS pour mener des recherches sur la scoliose de l'enfant. Une utilisation prolongée en pédiatrie est rendue possible par le fait qu'en intégrant un principe de détection par balayage, justement mise au point par le prix Nobel de physique Georges Charpak, qui réduit de 50 à 85 % la dose de radiation reçue par le patient, comparé à un système standard de radiologie. À titre de comparaison, un passage dans EOS représente l'équivalent d'une semaine de rayonnement naturel.
. Volet « e-santé »
« Un outil très pertinent et sérieux pour faciliter le quotidien des patients sous AVK et leur suivi par les médecins », a salué le jury du prix Galien, en plébiscitant l'application « Mon carnet AVK », au volet e-santé.
Conçue par le Pr Sébastien Faure, professeur de pharmacologie à l'université d'Angers, en partenariat avec la société Observia, l'application gratuite, téléchargeable sur tablette et téléphone mobile, est destinée à faciliter la gestion au quotidien des antivitamines K (AVK), notamment à prévenir les risques d'hémorragie. Plus d'un million de Français sont traités par ces anticoagulants. « Dans le cadre d'une formation sur les AVK, un pharmacien victime d'une phlébite me racontait avoir cherché en vain une application pour gérer son traitement. Je me suis aperçu qu'il y avait un vrai besoin », explique le Pr Faure, par ailleurs passionné par les nouvelles technologies.
« Mon carnet AVK » permet de saisir les résultats d'INR en fonction des doses d'anticoagulants, de réaliser des tableaux et graphiques à partir des données du patient, de renforcer la coopération entre les professionnels qui suivent le patient - dont les pharmaciens depuis 2012, de gérer les rappels automatiques pour les dates de réalisation de l'INR, les heures de prise de l'AVK et les doses, et de rappeler les « 7 règles d'or » du traitement. « Mon carnet AVK » a été téléchargé quelque 400 fois depuis son lancement en 2016.



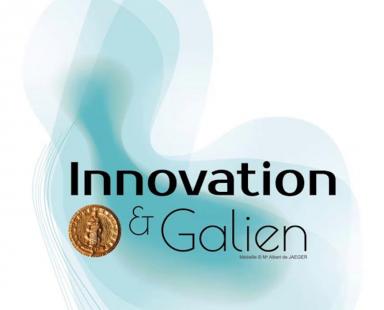

Pause exceptionnelle de votre newsletter
En cuisine avec le Dr Dominique Dupagne
[VIDÉO] Recette d'été : la chakchouka
Florie Sullerot, présidente de l’Isnar-IMG : « Il y a encore beaucoup de zones de flou dans cette maquette de médecine générale »
Covid : un autre virus et la génétique pourraient expliquer des différences immunitaires, selon une étude publiée dans Nature