AVANTAGE du sujet : lorsque les philosophes dissertent sur la substance ou le cogito, on peut se moquer éperdument de leur vie privée. Avec un « objet » comme l'amour, les prises de position, éloges ou rejets, nous mettent en prise de façon assez voyeuse sur les biographies : comment séparer chez Kierkegaard le « Traité du désespoir » de sa rupture avec Régine ? Alors, allons-y, et contre le triste Schopenhauer, qui décrétait que l'amour était «une matière que nul n'a encore traitée», constatons que dans tous les grands systèmes, il a fini par arriver, mais dans quel état ?
Si Platon n'ouvre pas forcément la chronologie, il est celui qui contribue très tôt à gâcher le mets avec le discours d'Aristophane dans « le Banquet ». Il décrit les premiers êtres comme des androgynes rattachés par la nuque. Voulant monter sur l'Olympe pour quereller Zeus, ce dernier les coupa en deux, séparant à jamais la partie femelle de la partie mâle. Et voilà ! A partir de ce texte qui passionna Freud, s'engendre toute la lamentation à venir : le désir de l'autre est marqué par le manque, la nostalgie de la complétude perdue ; l'amour s'inscrit comme douleur que nous croyons soigner au gré de nos rencontres, mais comme le chantera vingt siècles après Leonard Cohen, « There is no cure for love ».
Cela ne s'arrange pas avec Lucrèce. Dans le livre IV du « De natura rerum », il identifie l'amour au supplice de Tantale, l'eau disparaît dans le sol dès qu'il se baisse pour étancher sa soif, l'amant n'est jamais rassasié, tendu par l'inquiétude, menacé par l'excès. L'Ubris qui nous pousse au toujours plus, «c'est bien le seul cas où plus nous possédons, plus notre coeur brûle d'un funeste désir«, écrit Lucrèce.
Il y a plus, c'est-à-dire pire. Lucrèce a le premier insisté sur la violence de l'acte sexuel où les corps s'encastrent, «ils joignent leurs salives, bouche contre bouche s'entrepressent des dents, s'aspirent en vain...». Lacan nous le dira, il n'y a pas de «rapport sexuel» mais des menées intrusives vers et dans le corps de l'autre.
Enfer et catastrophes.
Sautons par dessus quelques siècles, ce qui ne veut pas dire que nos carnassières n'ont pas débusqué quelque gibier, mais tout de même, qui est plus emblématique du désert de l'amour que Jean-Jacques Rousseau ?
«Lui dont les femmes furent l'enfer portatif sa vie durant», décrètent durement nos coessayistes. Notre Jean-Jacques Rousseau semble tout entier dans l'impensable « Nouvelle Héloïse » qu'elles ont eu le mérite de relire. Dans ce chef-d'oeuvre lacrymal, disent-elles, s'est effondré «le grand rêve romantique de Rousseau qui entendait réconcilier la passion physique et la moraline protestante dans une bergerie suisse de carton- pâte». Rousseau pousse à l'extrême l'idéalisation de l'amour et découvre avant Stendhal la béatitude de la cristallisation. Mais voilà, «dès qu'on est confronté aux femmes en chair, la catastrophe menace». A notre humble avis, elles ont tort de se moquer, ce n'est pas si facile...
Une question aux auteures sur le « cas Rousseau » : comment ont-elles pu laisser passer le passage des « Confessions » où Rousseau dit la jouissance d'avoir été fessé très jeune par une bonne d'enfant, Mlle Lambercier ? Il dit avoir découvert là le plaisir d'être humilié, (le psychanalyste René Laforgue fera de notre Genevois l'un des rares à avoir «réussi dans l'échec»). Il dit, confesse... que toute sa vie sentimentale en a été marquée.
Dans leur grande série : l'amour n'est pas aimé, le tandem Lancelin-Lemonnier scanne Kant, le vieux Chinois de Königsberg. On connaît la chanson : Prussien, luthérien, piétiste, misogyne, auteur d'une morale invitent à se défier des inclinations. Il finit pourtant sa vie en inventant un appareil pour tenir les bas. Kant inventeur du porte-jarretelles ? Et par ailleurs moins rigide qu'il n'y paraissait.
De Nietzsche au néant.
Il y a bien sûr le pire avec Schopenhauser, pour qui l'amour est une ruse de l'espèce : l'attrait, les violons, tout ça c'est uniquement fait pour que l'humanité permane, et l'homme ne sait même pas que son trouble pour les décolletés vertigineux correspond à la certitude que le bébé sera richement nourri.
On s'est trompé, le pire c'est Nietzsche. L'amour l'enthousiasme, il est enfant de Bohème, est incarné par la folle liberté de Carmen. Puis il y a la vie solitaire et errante avant de tomber dans les rets de la dévorante Lou Salomé qui l'attellera à une charrette et lui préférera un cheval plus beau et plus musclé, Paul Rée. Entre-temps, Nietzsche, le chaste par nécessité, au seuil de la folie, aura, on le sait, utilement réglé son compte au christianisme : celui-ci «a donné du poison à boire à Eros, il n'en est pas mort, mais il est devenu vicieux» (« le Gai Savoir »).
Un vieux philosophe bourru et nazifié pouvait-il durablement s'unir à une jeune étudiante juive, alors que la Teutonne Elfride menace ? Peu d'être mais beaucoup de néant pour les amants du Flore ( «les époux Fourniret de l'existentialisme» ?), convaincus d'avoir conclu le pacte de l'amoralisme sexuel. Si vous mettez des noms sur ces personnages, c'est que vous êtes aussi forts en philo qu'en impasses amoureuses.
Notre époque n'est pas tendre pour la tendresse, plus « Meetic » que mythique, et un haut personnage peut se permettre de ridiculiser la princesse de Clèves. Eh oui ! Restent le sexe, la drague sur Internet et les ricanements peut-être fondés de Michel Houellebecq. N'était-il pas ridicule, Cesare Pavese, qui écrit à la fin du « Métier de vivre », et avant de se donner la mort à Turin, «On se tue parce qu'un amour, n'importe quel amour, nous révèle dans notre nudité, dans notre misère, dans notre état désarmé, dans notre néant».
Aude Lancelin, Marie Lemonnier, « les Philosophes et l'amour », Plon, 246 p., 19,90 euros.

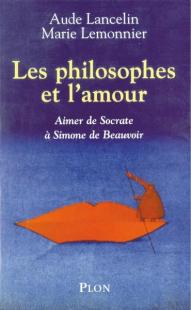
Pause exceptionnelle de votre newsletter
En cuisine avec le Dr Dominique Dupagne
[VIDÉO] Recette d'été : la chakchouka
Florie Sullerot, présidente de l’Isnar-IMG : « Il y a encore beaucoup de zones de flou dans cette maquette de médecine générale »
Covid : un autre virus et la génétique pourraient expliquer des différences immunitaires, selon une étude publiée dans Nature