Malgré un large recours au dépistage, un nombre encore trop important de personnes découvrent leur séropositivité au moment du diagnostic du sida. Cette méconnaissance du statut sérologique représente en 2002 plus de 50 % des nouveaux cas du sida en France.
« Avec 4,3 millions de tests effectués dans l'ensemble des laboratoires en 2001, le recours au dépistage est plus élevé en France que dans les pays voisins », indique le Pr Lucien Abenhaïm. Cependant, le retard au dépistage ne permet pas le traitement précoce des personnes concernées et entretient la transmission du VIH, en particulier au sein des couples.
Les motifs de non-recours sont encore imparfaitement connus, mais on sait qu'il concerne surtout les femmes d'origine subsaharienne et les homosexuels de sexe masculin. Ces derniers présentent la particularité de présenter un taux de dépistage parmi les plus élevés d'Europe (86 % ont fait l'objet d'un dépistage au cours de leur vie). Or, selon les données épidémiologiques portant sur le premier semestre 2002, 45 % des cas de sida liés à une contamination homosexuelle n'ont pas été dépistés auparavant, ce qui démontre l'intérêt de la répétition des tests dans cette population.
D'où le thème choisi par la direction générale de la Santé pour la nouvelle campagne antisida : le dépistage. « Nous souhaitons modifier sérieusement la perception sur la validité du test », souligne le Pr Abenhaïm. Pendant longtemps, en effet, le préservatif a été considéré comme la seule stratégie efficace de prévention. « Cela était vrai en situation d'épidémie, telle que nous la connaissions il y a dix ans. Aujourd'hui, nous sommes en situation de pandémie. Jusqu'à présent le test, dans sa visée préventive, a été uniquement envisagé pour les nouvelles relations ou en réaction à une situation de risque. Or la connaissance de son propre statut virologique n'est pas suffisante dans le cadre d'une relation qui s'installe ou qui dure. Connaître le statut virologique du partenaire est fondamental avant de cesser l'utilisation du préservatif », poursuit le Pr Abenhaïm. Les données sur les comportements des jeunes, en particulier, montrent qu'ils utilisent le préservatif, mais qu'ils l'abandonnent rapidement sans avoir fait le test. Et chez les femmes d'origine africaine, « il existe une difficulté à demander le test à leur partenaire ».
Des populations cibles mises en scène
Conformément à la programmation triennale de prévention établie avec les associations en mars 2001, la campagne cible non seulement le grand public, chez qui la vigilance doit être maintenue, mais aussi les populations les plus concernées.
Trois films ont donc été réalisés dans le cadre de cette campagne, « Sida, le test, c'est important ». Leur but est de mettre en scène des situations où la demande de test est importante. Le premier, de 35 secondes, montre un jeune couple hétérosexuel formé depuis trois mois et qui décide de ne plus utiliser le préservatif. Dans le second (35 s), la demande de test intervient dans un couple homosexuel qui a abandonné le préservatif : l'un des partenaires vient d'apprendre qu'un garçon avec lequel il a eu une relation peu de temps auparavant est séropositif.
Le troisième film, plus long (50 s), s'adresse pour la première fois aux personnes d'origine subsaharienne. Une jeune femme insiste auprès de son conjoint pour qu'il fasse le test.
Ces films seront diffusés jusqu'au 21 décembre sur les 6 chaînes hertziennes, sur le câble et le satellite. Au total, 850 diffusions sont prévues.
La campagne télévisée sera suivie d'actions visant à faire évoluer le dispositif de dépistage existant. En particulier, la formation des personnels des CDAG (centres de dépistage anonyme et gratuit) devrait améliorer le conseil préventif à l'occasion du dépistage et/ou de la remise du résultat. De même, des recommandations sur les bonnes pratiques du dépistage (VIH, IST, hépatites) seront revues en relation avec le corps médical. Les missions des CDAG seront d'ailleurs étendues au dépistage des infections sexuellement transmissibles.
Enfin, l'amélioration de l'articulation entre le dépistage et la prise en charge médico-sociale vise prioritairement à diminuer le nombre de personnes perdues de vue après un dépistage.
Mieux cibler la prévention
Après deux années de travail, le commissariat général du Plan a rendu public le rapport de l'instance d'évaluation chargée d'analyser la politique de lutte contre le sida 1994-2000. Il souligne la qualité de la prise en charge médicale et la diffusion rapide des traitements mais relève des insuffisances du côté de la prévention et de la prise en charge. Le rapport recommande des actions mieux ciblées et prône, en particulier, la mise en place d'une allocation spécifique pour les personnes malades.
« L'exercice a été long et difficile, souligne d'emblée le commissaire au Plan, Jean-Michel Charpin. Les travaux ont été interrompus après la démission du président précédent, Pierre Ducimetière, qui déplorait les lacunes du système d'information sur le sujet. Le projet n'a été relancé qu'en avril 2001. »
Mise en uvre à la demande du ministère de la Santé, l'instance présidée par Christian Rollet, inspecteur général des Affaires sociales, a donc remis son rapport sur l'évaluation de la politique contre le sida menée en France depuis le milieu des années quatre-vingt-dix. Trois domaines devaient être analysés : la prévention, l'accès aux soins et la solidarité auprès des personnes atteintes. « La période est suffisamment longue pour appréhender la dynamique de cette politique. De plus, elle a été marquée par l'arrivée des trithérapies, ce qui a permis d'étudier la capacité de réaction des pouvoirs publics », note Christian Rollet. En effet, parmi les aspects positifs des conclusions figure la bonne aptitude à l'innovation. « Répondant à l'urgence, la politique a souvent eu des inflexions pertinentes », poursuit Laure de la Bretèche, rapporteure générale. « Le poids de l'affaire du sang contaminé a conduit à la prudence et à un effort financier constant », ajoute-t-elle.
La prise en charge médicale, marquée par la mise à disposition large et rapide des nouveaux traitements apparus en 1996, est un des aspects très positifs mis en avant par l'instance. Cependant, cette réactivité et cette flexibilité se grèvent « d'un manque de suivi des actions au quotidien ». Par ailleurs, les objectifs en matière de prévention ont « sans doute été trop ambitieux ».
Une option libérale
Si la prévention auprès du grand public est jugée efficace, elle manque la cible des personnes les plus concernées : les migrants, les homosexuels, les usagers de drogues, les personnes en situation de précarité.
« Les caractéristiques de l'épidémie ont très vite conduit à poser le problème des libertés publiques, d'atteinte à la vie privée et de respect des personnes. Il y a eu des tentatives de type autoritaire. Finalement, on peut dire qu'on a évité cet écueil, indique Christian Rollet. Ce débat séculaire s'est conclu par une option libérale, mais a sans doute compliqué la tâche des acteurs, voire a réduit leur efficacité. »
Parmi ses recommandations, l'instance conseille donc des actions plus ciblées : « Aujourd[226]hui, les craintes de susciter des phénomènes de stigmatisation ne paraissent plus d'actualité, dans une société qui semble montrer, au travers des enquêtes d'opinion menées sur la période, une réelle maturité dans la compréhension du sida et de ces enjeux individuels. »
Malgré certaines avancées, la prise en charge sociale présente encore quelques faiblesses. L'espérance de vie des malades s'est allongée et les outils existants ne sont pas adaptés à leur pathologie. L'instance recommande que soit menée avec les responsables de l'assurance-maladie une réflexion sur une allocation pour longue maladie dont le montant serait modulé en fonction des phases de l'état de santé. Cette allocation pourrait bénéficier à d'autres catégories de malades. La réflexion doit porter également sur le retour au travail et l'accès à l'emprunt, mais les instruments adéquats sont difficiles à mettre en uvre.
Dépistage obligatoire en 2003
Un des points importants des recommandations concerne la mise en place d'un système de collecte de données épidémiologiques en vue de mesurer l'incidence de la séropositivité. La mise en place du dépistage obligatoire de la séropositivité en janvier 2003 devrait aider à remplir cet objectif.
Enfin, parmi les autres recommandations, l'instance demande la suppression des tests de dépistage prénuptiaux, trop archaïques, ainsi qu'une concertation sur les tests à l'insu, pratiqués en milieu hospitalier, qui doit être envisagée.

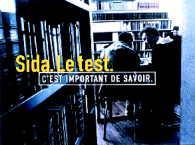
Pause exceptionnelle de votre newsletter
En cuisine avec le Dr Dominique Dupagne
[VIDÉO] Recette d'été : la chakchouka
Florie Sullerot, présidente de l’Isnar-IMG : « Il y a encore beaucoup de zones de flou dans cette maquette de médecine générale »
Covid : un autre virus et la génétique pourraient expliquer des différences immunitaires, selon une étude publiée dans Nature