« JE NE SUIS PAS ECARTELE entre ma conscience de praticien et les enseignements du magistère romain, mais je reconnais qu'il m'arrive de me sentir tiraillé », confie le Dr Edmond Tomkiewicz, généraliste à Goussainville (Val-d'Oise). Ce praticien engagé en Eglise (il est président de l'Association Saint-Côme et Saint-Damien, qui organise des pèlerinages de médecins catholiques) est connu dans sa clientèle pour ses options religieuses. « Et elles ne me stigmatisent pas du tout, se félicite-t-il. Tout au contraire, alors que je soigne des patients issus d'ethnies de plus en plus nombreuses (hindous, pakistanais, musulmans, etc.), je suis toujours heureux d'observer que la confiance que ces non-chrétiens me portent procède souvent de l'image de Jean-Paul II : celle d'un homme qui respecte la vie quoi qu'il arrive. Là-dessus, le message est clair et il est bien perçu par la plupart de mes patients. »
Le Dr Tomkiewicz lui-même se reconnaît dans les messages adressés par le pape au corps médical, « quand il nous explique que nous sommes les instruments du Seigneur pour venir au secours des malades. Ou quand il condamne l'acharnement thérapeutique. Ou encore quand il nous encourage à venir en aide aux plus handicapés, aux plus démunis. Ces soucis exprimés par le saint-père reflètent bien le respect de la déontologie tel que le vit la très grande majorité des médecins. »
Prescriptions dictées en conscience.
Mais il y a des sujets pour lesquels les directives « en ligne droite » ne sont guère dans l'air du temps. « C'est vrai que, s'agissant de la contraception, j'expose à mes patientes l'intérêt des méthodes naturelles, mais je dois parfois faire face à des demandes de moyens dits artificiels. Dans ces situations, c'est ma conscience qui me dicte, selon le concret de chaque cas, la prescription la plus appropriée. »
Pour ce généraliste catholique, une ordonnance pour la pilule enfreint certes les directives précises de Rome, mais, s'empresse-t-il d'ajouter, « le Christ ne rejette pas le pêcheur, il ne condamne pas la femme adultère. Et le pape lui donnerait certainement l'absolution ! L'Eglise, il faut le souligner, est un corps vivant ; ses membres doivent s'adapter à notre temps et aux besoins de l'humanité en écoutant la voix de leur conscience. »
« Quand même, cette histoire de contraception, pour les médecins catholiques, c'est un sujet d'embarras, opine le Dr François Mabille, psychiatre dans le Val-d'Oise, animateur d'équipes de pastorale de la santé dans le diocèse de Pontoise. Mais, explique-t-il, le principal reproche que je ferais à la ligne développée par Jean-Paul II en matière d'éthique reste l'attitude adoptée face au fléau du sida. Certes, l'Eglise est en train d'évoluer depuis quelques mois vers un langage plus acceptable. La réprobation, pendant des années, de l'usage du préservatif s'est inscrite dans un raisonnement religieux en matière de sexualité que je ne trouve pas très intéressant. Au fil des générations, la morale chrétienne sur la sexualité a été source de trop de mal. Comme psychiatre, et psychiatre catholique, face aux cas de souffrance psychologique, je déplore que l'Eglise ait surtout tenu un langage de culpabilité. C'est une arme à double tranchant : d'une part, la culpabilité peut protéger des catastrophes et ouvrir la voie bienfaisante au pardon ; d'autre part, elle risque d'enfermer le patient dans un rituel et d'encapsuler sa névrose. »
« Et pourtant, s'étonne lui-même le Dr Mabille, chaque fois que je me plonge dans un texte de Jean-Paul II sur l'éthique, je suis convaincu par la finesse des arguments et la justesse de la pensée. Mais quand j'entends l'écho qu'il reçoit dans la société, je suis bien obligé de constater qu'il y a un problème : le discours de Rome ne passe pas. »
« Parmi d'autres, les médecins, immergés qu'ils sont dans les dimensions pratiques des problèmes, sont appelés à répondre aux demandes du public et n'ont guère la faculté d'envisager la dimension spirituelle des choses ! La plupart d'entre eux, même quand ils sont chrétiens, n'ont pas le temps de s'attarder sur le déphasage entre les directives du Vatican et leurs pratiques quotidiennes. »
Un indéniable malentendu culturel.
« C'est vrai, convient le Dr Bruno Cazin, qui partage son temps entre le Chru de Lille, où il est hématologue, et Dunkerque, où il assume les charges de curé de paroisse et de vicaire épiscopal, j'en suis parfaitement conscient, la pensée de Jean-Paul II n'est pas toujours bien reçue dans le public, elle va souvent à l'encontre de la société civile. Dans un monde qui érige la liberté individuelle en absolu et qui considère que cette liberté tend à la totale maîtrise du corps, le pape a martelé un discours souvent perçu comme dur. Il a régulièrement stigmatisé la civilisation de la mort et tenté de restaurer un discours positif mal compris. »
Pour le prêtre-médecin, « nous sommes en présence d'un indéniable malentendu culturel, avec des modes, notamment dans le monde médical, où, sous couvert d'exalter le progrès, on oublie énormément de souffrances sur le plan économique et social. On voudrait faire croire que Jean-Paul II a pris le contre-pied du progrès, alors qu'il s'est appliqué à nourrir une réflexion complexe sur l'homme faible, victime des oppressions et des injustices, à l'image de l'homme blessé qu'est le Christ. De ce point de vue, le pape a témoigné dans sa chair et par l'unité de toute sa vie de ce souci du faible, dans un monde qui lie souvent dignité et performance. »
Bref, souligne Bruno Cazin, « il faudrait poser les problèmes éthiques dans leur complexité et admettre à la suite de Jean-Paul II qu'ils ne sont pas univoques ».
« Les hommes d'aujourd'hui, médecins compris, confirme le Dr Tomkiewicz, auraient certainement besoin de plus d'explications. »
« Et l'Eglise, ajoute le Dr Mabille, de plus d'expérience. L'avenir, à cet égard, passe sans doute par l'ordination d'hommes mariés qui donnera aux clercs plus de maturité en matière de morale et de morale sexuelle en particulier. »

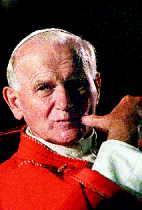
Pause exceptionnelle de votre newsletter
En cuisine avec le Dr Dominique Dupagne
[VIDÉO] Recette d'été : la chakchouka
Florie Sullerot, présidente de l’Isnar-IMG : « Il y a encore beaucoup de zones de flou dans cette maquette de médecine générale »
Covid : un autre virus et la génétique pourraient expliquer des différences immunitaires, selon une étude publiée dans Nature